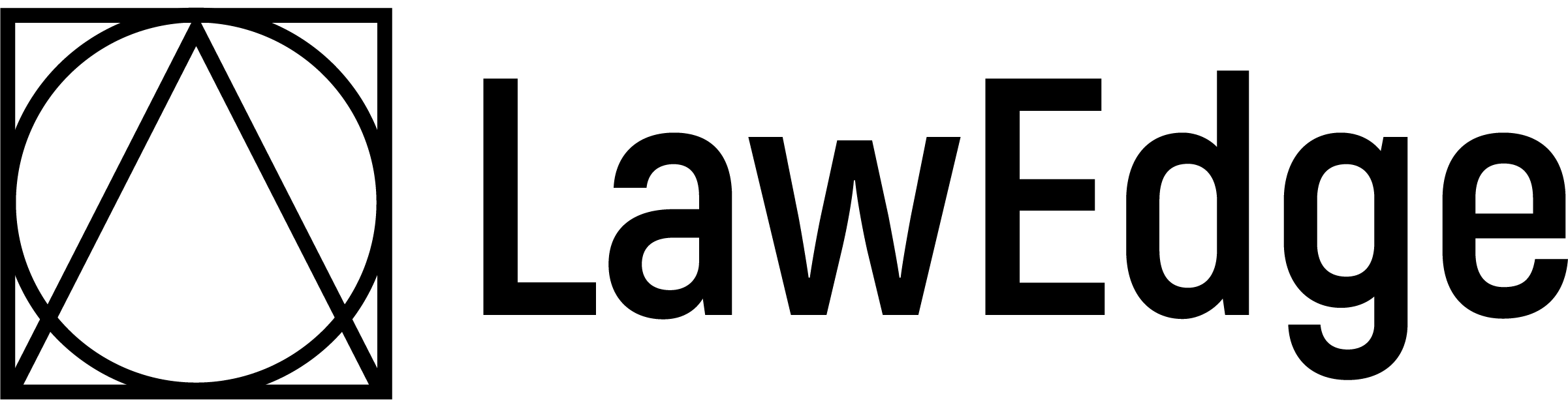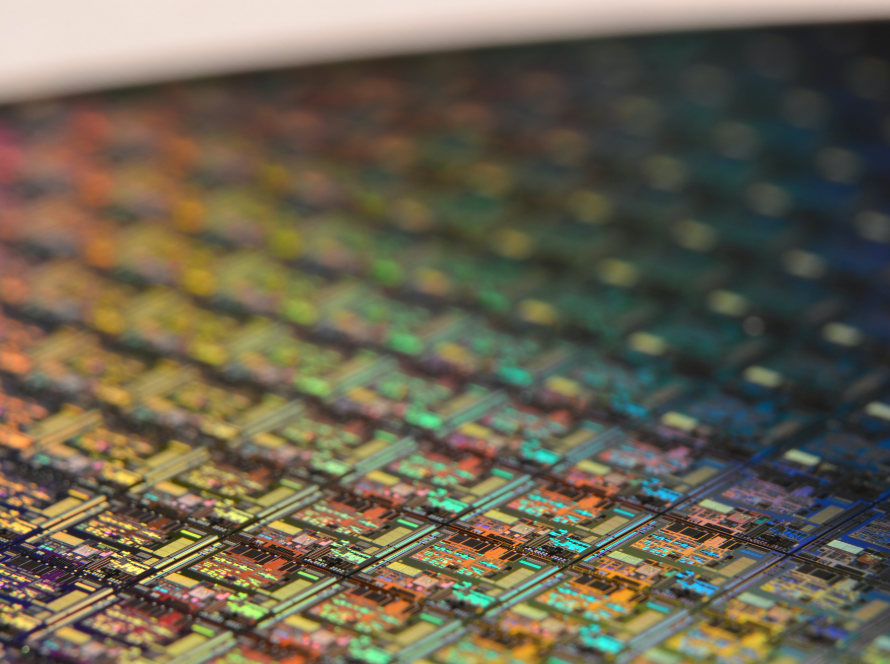Quand céder à des pratiques de pression, qui répondent à la définition du « chantage », va à l’encontre de l’héritage culturel.
Quel type de justice pour les Etats démocratiques ?
Les affaires des fleurons français[1] ayant dû payer de lourdes amendes au Trésor Public américain ont fait couler beaucoup d’encre depuis les années 2000.
Nombreuses ont été les lignes écrites laissant entendre que les entreprises françaises n’avaient d’autre choix que d’accepter des « deals of justice », et unanime a été le constat de l’inadéquation des moyens de riposte mis en place par l’exécutif français et européen pour protéger entreprises face à l’extraterritorialité des lois américaines.
Cette situation illustre les limites d’un système dans lequel les acteurs ont perdu le souffle vital qui a donné corps à un État démocratique libéral en capacité de protéger ses populations et ses entreprises.
Faute de glissement vers un système où les limites à l’ingérence ne sont plus garanties dans le rapport de forces, les acteurs doivent serrer les rangs et reformer des coopérations organiques au sein desquelles circulent l’information pertinente, construites autour d’un socle de valeurs partagées au service de la sauvegarde des limites.
Etat des lieux
Dans un rapport intitulé « quelles solutions pour la France et l’Europe face à des pratiques internationales d’extraterritorialité du droit ? »[2] de l’IHEDN, les auteurs proposent les pistes d’actions suivantes: mise en place d’une banque européenne d’exportation, d’un euro numérique et une solution de paiement souveraine européenne pour contrer le nexus américain, ainsi que les règlements européens en matière numériques pour constituer une alternative crédible pour l’hébergement des données en Europe.
Ils préconisent en outre « le renforcement de l’arsenal juridique » en indiquant que « la révision du règlement de blocage européen permettrait de porter le dialogue à un niveau étatique et soustraire nos entreprises des pressions d’Etat tiers ».
On nous permettra d’en douter, vu l’inefficacité de ces mesures depuis leur introduction en France depuis 1968.
Les auteurs concluent : « ces évolutions nécessaires posent également la question du modèle juridique, à savoir, pour lutter à armes égales, s’orienter vers un modèle anglo-saxon basé en premier lieu sur les normes puis, à la fin, sur une négociation, ou bien conserver notre modèle porté sur une application stricte du droit adossé à un corpus législatif fourni ».
Dernièrement, dans une « note d’éclairage » de décembre 2024[3], l’Institut Montaigne de conclure :
« La question de l’extraterritorialité est d’une importance fondamentale pour l’Europe. Le débat devrait être normalisé et systématiquement faire partie intégrante de toute discussion transatlantique sur la sécurité économique. La position de l’UE ne sera prise en considération que si elle est en mesure de démontrer qu’elle a saisi les enjeux de l’extraterritorialité américaine et qu’elle a élaboré une stratégie crédible pour y faire face − une stratégie qui s’aligne sur les États-Unis lorsque cela s’avère nécessaire et qui s’y oppose lorsque l’extraterritorialité américaine porte atteinte à ses intérêts fondamentaux. »
Autant de solutions cantonnées au niveau fonctionnel et technique, comme si l’Etat démocratique n’était caractérisé que par le bon fonctionnement de sa dimension industrielle, matérielle et commerciale.
Et peu s’aventurent à poser la problématique qui fâche : comment une telle situation est-elle permise en démocratie ?
On repense alors à Tocqueville, qui s’est en son temps appliqué à montrer les contradictions des temps troublés auxquels il écrit, à la suite de la Révolution française, un 19e siècle où rien ne semble plus défendu, ni permis, ni honnête, ni honteux, ni vrai, ni faux, fait d’oppositions de postures et de nuisances idéologiques.
Que dit de notre Etat social démocratique la situation des entreprises françaises et européennes face aux pratiques de pression et d’intimidation des puissances extérieures ?
Des entreprises d’autant plus démunies qu’elles sont mal informées
Avoir les moyens de se battre dépend du rapport des forces en présence, certes.
La menace des peines de prison encourues en cas de violation du FCPA[4] ou de la loi RICO[5] a certainement plongé les décideurs dans un état de sidération, faisant passer les lourdes amendes infligées aux fleurons français pour des pis allers.
Mais les entreprises qui se sont acquittées des amendes avaient les reins solides, et auraient pu, si elles avaient voulu, réagir, ne serait-ce que pour se défendre. L’enjeu est donc ailleurs.
Cela dépend aussi de la connaissance de l’écosystème judiciaire, des rouages de la procédure et des coopérations possibles pour organiser sa défense.
Ainsi, la méconnaissance des mécanismes déployés aux Etats-Unis dans le cadre des deals of justice, et des moyens de défense disponibles, entretenue par l’hermétisme bien senti des parties prenantes, n’ont pas manqué pas de maintenir les acteurs dans une posture d’infériorité.
Cela dépend enfin d’une volonté et d’un courage de nature politique. Et celui-ci découle directement du sens que les acteurs donnent au système dans lequel elles évoluent, dans la confiance qu’elles peuvent placer dans les institutions régaliennes et donc de leur encrage culturel autour de valeurs communes partagées.
Peut-on encore affirmer que les valeurs de justice, d’indépendance et courtoisie qui ont fait le rayonnement de la diplomatie française soient à l’honneur aujourd’hui ?
Il s’est écoulé près de deux générations depuis la loi de 1968 dite de blocage, censée protéger les entreprises françaises faisant face à des demandes de communication de documents de la part d’entités étrangères.
On ne peut que faire le constat qu’il a souvent été traité des conséquences de l’extraterritorialité sans en questionner les causes. Il en résulte le maintien des individus et des entreprises, s’entend des PME et ETI, dans une certaine ignorance, tant des enjeux sous-jacents, que des alternatives possibles
Les manques dans le traitement du sujet de l’extraterritorialité
La question de l’extraterritorialité n’est pas souvent traitée sous l’angle des moyens de défense sur le plan judiciaire. C’est l’objet de notre propos.
Face au caractère non judiciaire des affaires en cause, il est communément avancé la pression qu’appliquent les administrations telles que le Department of Justice ou l’OFAC (Office of Foreign Asset Control, émanant du département du trésor américain) et la perspective des entreprises françaises de se voir retirer leurs licences d’exploitation sur le sol américain (mais aussi là où les américains étendent leur influence).
Mais s’émouvoir de la démultiplication des procédures sans incrimination, sans débat contradictoire sur examen de pièces, avec plaider coupable contre versement d’une somme d’argent, sera-t-il notre seul sursaut ?
Si « l’État de droit » a une signification , ce dernier n’est-il pas sensé justement être là, via les institutions judiciaires et les contre-pouvoirs, pour veiller à ce que des comportements déséquilibrés et arbitraires d’administrations trop puissantes, ne puissent se déployer sans contre-pouvoir ?
Ainsi, comment se fait-il que le recours au juge ne figure pas dans l’arsenal de défense des entreprises attaquées ? Serait-ce la crainte de réussir ?
L’administration américaine a donné le LA de la lutte « anticorruption ». Et ce de façon univoque depuis la dislocation de l’Union soviétique en transformant le système international dans lequel une certaine multipolarité s’exprimait jusqu’en 1991, pour devenir univoque sous la bannière des droits de l’Homme. Mais il faut cependant être deux pour danser le tango…
La trajectoire de demain dépend des décisions d’aujourd’hui
La vieille Europe est aujourd’hui, plus que jamais, à la croisée des chemins (6).
Ses richesses, matérielles, culturelles et civilisationnelles ont toujours été convoitées, et elles le seront encore demain. Mais l’Homme baigné de la lumière universelle n’est il pas aveuglé par son propre rayonnement, ne manque t il pas de discernement quand l’idéologie engendre le confort illusoire, qui en fait oublier que les appétits extérieurs attaquent le plus souvent quand la proie est affaiblie?
Le champ d’application des dispositions extraterritoriales, l’histoire écoulée depuis 1968, avec une révolution méconnue des médias de l’époque[7] et les cas révélateurs de prédation manifeste, nous donnent pourtant des clefs pour comprendre que l’histoire n’est pas forcément écrite d’avance, sauf quand on laisse les autres l’écrire.
Ne pas laisser les autres décider pour soi implique implique une révolution cognitive, pour chercher à comprendre les rapports de force, et de faire des choix éclairés. Les entreprises, françaises, et des autres Etats Membres ayant un droit à disposer d’eux mêmes, doivent être informées de leurs options, et ont leur mot à dire quant au type de système juridique qu’elles souhaitent se voir appliquer.
De leur moyens de défense et de leur avenir dépendent la sécurité et le bien être des populations.
Ce n’est pas parce que les dispositifs français mis en place pour « lutter » contre l’extra-territorialité se sont révélés plutôt inefficaces depuis 1968, qu’il n’existe pas de réels et efficaces moyens de défense.
Certains directs et d’autres indirects. Nous y reviendrons.
Or c’est de leur mise en œuvre effective que peut émerger une troisième voie permettant de désentraver les entreprises de l’injonction paradoxale qui leur est faite (soyez compétitives, mais soyez « compliant » !).
[1] Tecnip, Alcatel Lucent, Total, Alstom, Airbus, BNPParibas
[2] du rapport du comité 2 de la 57e session nationale « armement et économie de défense » de l’IHEDN (Revue Défense Nationale n°849 ,avril 2022)
[4]https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act
[5]https://www.justice.gov/jm/jm-9-110000-organized-crime-and-racketeering
[7] Eric Bronca, l’ami américain